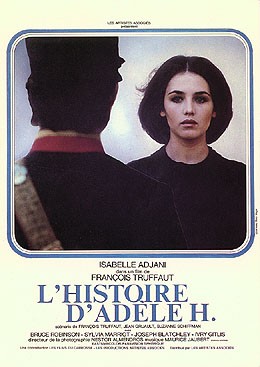Alfred Stevens, La Lettre de rupture, vers 1867,
huile sur toile H. 0,745 m ; L. 545 m,
Paris, Musée d'Orsay
Dès la lecture du titre, le spectateur comprend tout de suite le thème de cette œuvre. Après avoir considérer de haut en bas la longue figure féminine qui se détache claire sur un fond sombre, le regard s’arrête sur le détail presque anodin de la lettre que la femme tient dans sa main droite. Détail presque anodin, en effet, parce que le peintre s’est plu à donner au papier le même colori que la robe, si bien que l’on a l’impression que la femme tient plutôt un pan de celle-ci. Mais ce détail est loin d’être anodin car il est le centre du drame qui se joue sur cette toile et que le titre éclaire d’un jour sans équivoque : Cette femme au regard triste et songeur vient de recevoir une lettre de rupture.
Le peintre belge Alfred Stevens (1823-1906) s’est fait une spécialité dans la représentation dans leur quotidien de femmes issues d’un milieu aisé. Pourtant, ce ne sont pas des portraits de riches bourgeoises, malgré l’impression que l’on en a, mais bien des scènes de genre à un seul personnage. Les titres de ses œuvres permettent d’ailleurs de discerner les genres. Loin d’être de « simples » portraits, les œuvres de Stevens racontent une histoire. Elles dépeignent une seconde de la vie d’une femme, un moment décisif, mais, laissent la porte ouverte à l'interprétation. Le spectateur saura deviner les tenants et les aboutissants de la scène. C'est là tout l'art de l'artiste : laisser le spectateur faire preuve de suffisamment de sagacité pour comprendre ses tableaux.
Dans la toile qui nous préoccupe, Stevens montre une femme à l'instant précis où elle vient de finir la lecture de la lettre et, encore sous le choc des mots, subit les assauts de sentiments disparates. On ne lit presque rien sur son visage mais l’on sait qu’elle éprouve de la haine, de l’amour, de la jalousie, de la tristesse, de la colère, du désespoir… Tous ces sentiments qui affluent en même temps l’empêchent de parler, de bouger, de pleurer, de crier… Il est facile pour le spectateur d’interpréter ce que la jeune femme ressent. Tout être humain a vécu la même situation.
D'un point de vue technique, le peintre accentue l'impression de cassure grâce au décor de l'œuvre. Nous l’avons dit, il s’agit d’un fond sombre que n’anime nullement un coin aux couleurs chaudes, des oranges et des jaunes. Sur la droite, dans une mince bande verticale se voit une fleur dans un bac. Ce détail nous donne la clef pour comprendre où se tient la jeune femme, elle s’est réfugiée dans l’ombre d’un paravent pour pouvoir lire secrètement la lettre qu’elle vient de recevoir. Mais dans ce coin qu’elle avait pu croire un refuge et dans lequel elle semble flotter parce que l’on distingue difficilement le sol, s’agitent des formes sombres, visualisation des tortures qui harcèlent son esprit. Même la tache aux couleurs chaudes au-dessus de son épaule droite, n’égaie pas l’espace. Ce lieu est la figuration de ses sentiments : écarté de la vie quotidienne, tout y est brisé, informe, taché, avili, à l’image de son amour.
Par des sujets comme celui-ci, qui racontent des anecdotes réalistes que tout un chacun connaît, Alfred Stevens a acquis une grande renommée dans la haute société du second Empire puis de la troisième République. Pourtant, ce ne sont en rien des tableaux que l’on serait tenté de classer dans l’Académisme. Beaucoup de choses s’y opposent en effet :

Tout d’abord, Stevens est l’un des premiers à s’intéresser aux effets de l’art japonais. Parce que cet art s'oppose à la tradition occidentale, il peut en effet être considéré comme une influence fondamentale de la modernité. Dans son tableau, Stevens lui donne une place prépondérante. Ainsi, le détail de la fleur dans son bac, de l’autre côté du paravent et que celui-ci cache à moitié, symbole d’une jeunesse naïve qui vient de se briser, est tout ce qu’il y a de plus japonisant. De plus, d’une manière assez extraordinaire, bien que la toile soit d’un format assez banal, le découpage de l’espace pictural en trois longues bandes verticales donne l’impression que l’œuvre est beaucoup plus longue, comme un
kakemono japonais.
Par ailleurs, contrairement aux thèmes des œuvres dites académiques, les siens ne sont pas tout de suite reconnaissable, comme nous l’avons vu. Il faut un certain temps d’étude du tableau et souvent l’aide du titre pour en comprendre toute la portée anecdotique.
Surtout, Alfred Stevens est un peintre indépendant, non « inféodé » à l’Institut puisqu’il a toujours vendu ses œuvres de la main à la main, grâce au Salon et bien sûr par l’intermédiaire des marchands d’art.
Finalement, en représentant des scènes réalistes de la vie quotidienne et non des scènes historiques ou religieuses, il est un peintre de la vie moderne. L'un des premiers d'ailleurs, et, à ce titre, il peut être considéré comme le précurseur de Manet, dont il est un ami, de Fantin-Latour ou de Caillebotte.
Malgré cela, on peut se demander pourquoi Alfred Stevens n’est pas rentré dans la postérité ? Nous avons déjà donné la réponse à ce fait : il a été l’un des peintres les plus renommés de la deuxième moitié du XIXe siècle. Cherchant à plaire pour vendre et n’innovant que très peu, il a trouvé ses clients dans la bourgeoisie.
Cet exemple nous permet alors de démontrer qu’à cette époque l’art ne s’est pas résumé à un affrontement entre l’Académie et l’Avant-garde comme on a eu trop vite tendance à croire. Il y avait aussi et surtout une multitude de peintres renommés ou inconnus qui ont cherché à vivre le mieux possible de leur art. Ceux-ci n’ont voulu ni faire de la grande peinture, ni s’adonner à un genre trop « moderne », parce que des deux côtés les œuvres ne se vendaient pas.
Il est vrai qu’il est facile de juger
a posteriori et de dire que les artistes qui n’ont pas été impressionnistes ne méritent pas l’intérêt. Mais, d’une part, il fallait une certaine aisance financière pour pratiquer un style qui ne se vend pas et d’autre part, il fallait se sentir prêt à pouvoir innover, ce qui n’est pas donné à tout le monde.




 La découverte des arts du cirque (histoire, disciplines, genres esthétiques...) s’intègre dans l’enseignement transversal de l’histoire des arts. La pratique du cirque s’inscrit quant à elle dans le programme d’EPS (acrobatie, jonglage, gymnastique sportive et dansée), celui de français (expression orale liée à l’art clownesque) et celui d’éducation artistique (maquillage, fabrication de costumes et de décors, musique). Enfin, les valeurs transmises par la pratique du cirque (estime de soi, cohésion du groupe, entraide…) participent pleinement aux apprentissages d’éducation civique.
La découverte des arts du cirque (histoire, disciplines, genres esthétiques...) s’intègre dans l’enseignement transversal de l’histoire des arts. La pratique du cirque s’inscrit quant à elle dans le programme d’EPS (acrobatie, jonglage, gymnastique sportive et dansée), celui de français (expression orale liée à l’art clownesque) et celui d’éducation artistique (maquillage, fabrication de costumes et de décors, musique). Enfin, les valeurs transmises par la pratique du cirque (estime de soi, cohésion du groupe, entraide…) participent pleinement aux apprentissages d’éducation civique.