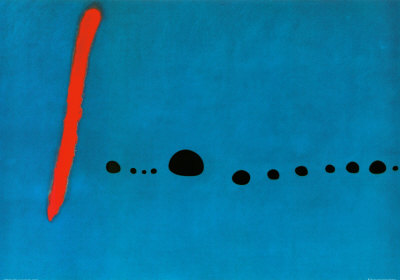Recueil de poèmes en hommage aux deux auteurs
L'Art russe dans la seconde moitié du XIXe siècle : en quête d'identité
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, de nombreux artistes se détournent, totalement ou partiellement, des modèles Occidentaux enseignés dans les académies de Saint-Pétersbourg et de Moscou pour élaborer un art national.
Le retour aux sources slaves, entre mythe, histoire et art populaire mais aussi la prise en compte de la réalité sociale et politique contemporaine favorisent l'émergence d'un art et d'un style "russe". Les peintres, notamment Répine, Kramskoï, Savistsky, aussi bien que les photographes tels que Boldirev, Dmitriev, Mazourine adhèrent à ce mouvement.
Cette quête d'identité trouve son apogée dans le mouvement néo-russe qui touche l'ensemble des disciplines artistiques. Il s'exprime notamment dans deux centres de créations: à Abramtsevo, près de Moscou et à Talachkino, près de Smolensk. Cette recherche se prolonge durant les années 1905-1910 dans le courant néo-primitiviste aussi bien en peinture chez Gontcharova, Larionov, Malevitch qu'en sculpture sur bois chez Golubkina ou Konenkov. Tous ces artistes assurent et revendiquent la fécondité de l'héritage de la Russie ancienne et moderne dans la genèse des mouvements d'avant-garde.
http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/archives/presentation-generale/browse/12/article/lart-russe-dans-la-seconde-moitie-du-xixe-siecle-en-quete-didentite-4234.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=252&cHash=6d3907db80
 Nils-Udo, "Maison d'eau" (1982), ilfochrome sur alumium, 124 x 124 cm. | ©Nils-Udo
Nils-Udo, "Maison d'eau" (1982), ilfochrome sur alumium, 124 x 124 cm. | ©Nils-Udo Pieter Bruegel the elder (ca. 1525-1569), Summer, 1568
Pieter Bruegel the elder (ca. 1525-1569), Summer, 1568 Jan Siberechts (1627-1703), Landscapestudy with trees, ca. 1672
Jan Siberechts (1627-1703), Landscapestudy with trees, ca. 1672


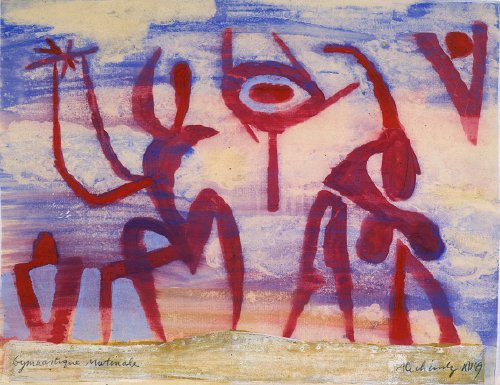 EXPOREVUE
EXPOREVUE