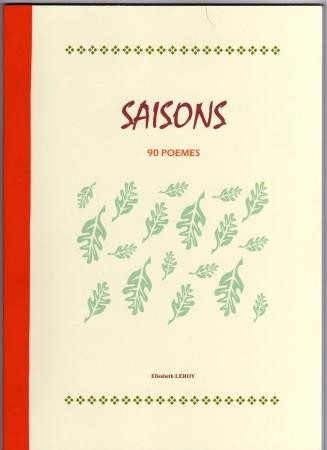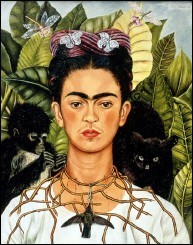Né en Argentine, il grandit dans l'Oural avant de rejoindre Paris. Il devient. écrivain à la Nouvelle Revue française, parcourt le monde pour «France Soir» et bâtit sa légende à force de livres éblouissants et de verres broyés entre les dents
C'est un Kessel étonnamment sobre, indifférent aux oeillades des jolies inconnues sur le pont de l'«Astu-rias», qui vogue vers Buenos Aires ce 12 août 1937. Jean Mermoz est mort huit mois plus tôt. La jeune gloire de l'Aéropostale, disparu au large de Dakar aux manettes de la «Croix-du-Sud», était son ami, son frère. Joseph Kessel, polygame sentimental, le coeur ouvert à toutes les aventures, place au plus haut la camaraderie virile et l'amitié. En guise d'adieu au disparu, il va écrire un livre. Tout au long de la traversée, on le voit sous la Voie lactée, crinière au vent, se recueillir sur cet océan que l'ami, le frère, tant de fois, a survolé.
Comme à son habitude, Joseph Kessel a vu les choses en grand. Son enquête sur Mermoz et «sa cohorte ailée» fera l'objet d'une série d'articles dans «France-Soir». La biographie sera publiée par Gallimard. Au Kessel de la fin des années 1930, au romancier de «la Steppe rouge» et de «Belle de jour», au grand reporter, auteur d'articles retentissants sur le trafic d'esclaves en mer Rouge, au prince noctambule des cabarets russes parisiens déterminé à «faire de civique jour un dimanche» et qui, au petit matin, signe en titubant des chèques en blanc pour payer la vodka et tous les verres fracassés, à cet homme-là, on ne refuse rien. Il est déjà, à l'aube de ses 40 ans, l'Homo kesselianus qu'André Chamson accueillera en ces termes en 1962 à l'Académie française. En attendant, le voici qui aborde après trois semaines de traversée la terre de Mermoz - en ce temps-là, seul le courrier franchit par avion les océans. Des journalistes l'attendent à hôtel, pressés de célébrer comme il se doit le retour au pays du «juif argentin». Car Kessel a vu le jour non loin d'ici, dans la pampa. Le 10 février 1898, à Clara, dans une colonie agricole de Mosesville, peuplée d'émigrés des ghettos de Russie, naissait Joseph-Elie. Sur les bords du Tigre, là où les eaux du Panama rejoignent celles de l'Uruguay, là où Mermoz se baignait à la saison chaude, «Jef» Kessel sait que sa famille avait embarqué un jour pour la Russie et qu'il avait failli mourir de dysenterie au cours de ce périple de 18 000 kilomètres. Au beau milieu de l'Atlantique, ni son père médecin ni l'infirmier de bord ne savaient que faire pour sauver la vie de la petite chose famélique qui dépérissait dans les bras de Raïssa, sa mère, paniquée, épuisée au sixième mois de sa deuxième grossesse. Le capitaine avait prévu de jeter le peut corps par-dessus bord.
Quarante ans plus tard, Joseph Kessel n'oublie pas qu'il doit la vie à une jeune émigrante italienne qui proposa de nourrir au sein, en même temps que son propre enfant, un bébé squelettique qu'elle ne reverrait pas. Les Kessel s'installeront donc avec leur Yossienka (petit Joseph adoré) à Orenbourg, dans l'Oural. Les premières années du garçon seront bercées par le tintinnabulement des caravanes afghanes venues se ravitailler à la maison Lesk, épicerie pour nomades impeccablement tenue par Anton, le grand-père maternel. Puis ils émigrent en France. Cette enfance errante fera de lui un vagabond intraitable.
Mais pour l'heure, l'écrivain a rejoint Marcel Reine, autre figure de l'Aéropostale, pour refaire après Mermoz la traversée de la meurtrière cordillère des Andes, «cette chevauchée de neige et déglace, cette fureur pétrifiée dans un éternel assaut». Sur un authentique vieux zinc des débuts de la ligne, un Latécoère-28, les deux pèlerins volent jusqu'en Patagonie, bravant les vents des Andes et provoquant le destin - un atterrissage forcé est souvent fatal. Quelques archanges intrépides morts pour l'Aéropostale passent dans son beau roman sur Mermoz.
Des bateaux, Kessel en a pris bien d'autres avant l'«Asturias». «A moi venaient les mers de Chine, l'océan Indien, la mer Rouge et toutes leurs escales», écrira-t-il. Embarquer le 10 novembre 1918, à 20 ans, à bord du «Président-Grant» à destination de New York, fut sa première échappée vers un glorieux destin. Ce jour-là, la France fête une victoire à laquelle l'adolescent, qui sera toute sa vie «pressé d'avoir peur», a participé de justesse: son jeune âge ne l'a pas autorisé à s'engager dans l'aviation avant 1917. Dans l'escadrille S.29 qui lui inspirera «l'Equipage», premier roman à la gloire des mess enfumés et de la fraternité d'armes, il s'est découvert une fascination pour la guerre et un «attrait morbide pour la violence élémentaire des instincts». Afin de goûter davantage encore cette drogue dure, il rejoint les volontaires du «Président-Grant» pour une improbable mission de «soutien» aux forces blanches de Sibérie mobilisées contre l'Armée rouge naissante. C'est Corto Maltese à Vladivostok. Dans une invraisemblable pagaille qui comble son désir de chaos, des soldats des quatre coins du monde se demandent ce qu'ils font là, chaque nation ayant envoyé ses représentants dans l'affolement collectif. A l'Aquarium, on trinque à la russe au bras des entraîneuses, et les verres de vodka vides explosent sur le sol. Kessel fera sienne la bizarrerie locale.
Cette guerre finie, il va en trouver d'autres. Justement, l'Irlande gronde. L'insurrection contre la Couronne d'Angleterre devient sanglante et c'est bientôt pour «la Liberté», un des grands journaux français, qu'il met le cap sur Londres. Arrêté par les Anglais pour activité terroriste, le maire de Cork, embastillé à Brixton, refuse d'être jugé par ces «étrangers». Fasciné par «la foi la plus ardente» des sinn-feiners, Joseph Kessel raconte à ses lecteurs qui sont vraiment les hommes invisibles de l'IRA. La France aimait l'écrivain, elle se passionne pour le journaliste. Dix articles, et sa réputation de grand reporter est faite. Il a 22 ans.
Un autre bateau, pour la Russie soviétique cette fois. Joseph Kessel en rapporte une série d'articles sur la face cachée du bolchevisme et la «boue sanglante» de sa police secrète, la Tcheka, qui recrute parmi les illettrés et les repris de justice. Pour «la Revue de France i>, férocement anticommuniste, il signe un article mémorable intitulé «Silhouette de la Tcheka», fusillant Trotski d'une formule: «bourreau hors cadre». «Le Caveau n° 7», une nouvelle publiée au Mercure de France, achève de discréditer un régime qui transforme en monstres des hommes qui rêvaient d'égalité. Gaston Gallimard, directeur de la maison d'édition la Nouvelle Revue française, le remarque et lui demande un roman. «La Steppe rouge» sera publié en novembre 1922, sept nouvelles glaçantes sur la banalité du mal. Si Paul Valéry admire son talent pour traduire «l'épouvante et l'angoisse tontes mies et toute la force d'une vérité actuelle et incroyable», Paulhan et Rivière regardent de haut ce moujik échevelé qui considère que le sang et la misère sont le lot de la plupart des hommes. Qu'importe, Kessel est chez lui à la NRF.
Kessel est désormais partout où l'Histoire bascule. Et quand il n'y est pas, c'est elle qui vient à lui. Elle se présente en 1926 sous les traits d'un certain Haïm Weizmann, qui, à la mort de Theodor Herzl, a repris le flambeau du sionisme mondial. Celui qui sera un jour le premier président de l'Etat d'lsraël veut entraîner à Jaffa le grand Kessel, qui n'est pas très motivé. Le sionisme? Chimère attendrissante. Rêve sans lendemain de rescapés des pogroms russes. Le plus sage, pense-t-il, est que les juifs s'intègrent dans leurs pays d'accueil. Mais la passerelle du «Champollion» à peine franchie, Kessel, d'abord meurtri par le spectacle de ces pionniers en haillons, est ému par le chant d'un rabbin. Puis la joie intranquille du sionisme le gagne quand il découvre Tel-Aviv la fragile, où des préfabriqués s'alignent et buttent au pied des dunes de sable - à vaincre elles aussi. La vallée de Jezréel, ancien marécage infecté de malaria transformé en jardin fécond, achève de conquérir un homme conscient que «le plus petit brin d'herbe vous met l'âme à l'envers».
Israël ne se fera plus sans Kessel. Jef a trouvé sa «Terre d'amour» et lui restera fidèle quand elle sera terre de feu. Pour «France- Soir» il reviendra, le 14 mai 1948. A la douane de Haïfa, un jeune garçon apposera en caractères hébraïques sur son passeport avec un tendre sourire le visa n° 1 d'un Etat qui n'a même pas un jour, événement dont il fera le récit pour le quotidien parisien dans un article de une éblouissant entré depuis dans les annales de la presse. Sa signature sera si fortement liée à «France-Soir» et à son directeur, le légendaire Pierre Lazareff, que ce dernier demandera qu'on aille débusquer «le vieux lion» dans sa retraite d'Avernes pour écrire sa nécrologie, le jour venu.
Jef Kessel, qui disposait à «France-Soir» d'un crédit illimité pour parcourir le monde, était capable de faire grimper sur son seul nom les ventes d'un numéro de 100 000 exemplaires. Mais malgré cette ahurissante popularité, il faisait volontiers une brève non signée sur un incendie de poubelle au coin de la rue. Lui qui couvrira la Seconde Guerre mondiale et écrira avec son neveu Maurice Druon «le Chant des partisans»; lui qui à Londres promettra à de Gaulle un grand livre sur «l'Armée des ombres» ne sombra pas dans l'arrogance - sans doute s'adressait-il trop de reproches pour être vaniteux.
Car l'auteur du «Lion», livre vingt fois réédité en cinquante ans, perçu comme un demi-dieu, était miné par de puissants remords. Jamais il se s'est pardonné de n'avoir pas senti le désarroi de son jeune frère, Lazare, mort suicidé l'année de ses 20 ans, ni d'avoir trouvé sa mère mourante, boulevard Brune, l'hiver 1956, alors qu'il rentrait d'un interminable périple afghan. Rassemblant ses dernières forces, Raïssa Kessel s'était accrochée à la vie dans l'unique espoir d'embrasser une dernière fois l'éternel absent. Ce souvenir-là aussi brouillerait plus d'une fois ses yeux gris. Mais son tourment le plus lancinant fut d'avoir négligé Sandi, son premier grand amour, son coup de foudre en mer de Chine, sur un bateau, encore, que les amis du couple appelaient parfois «la sainte», tant elle pardonnait tout à son chien fou de mari, ses absences et ses nuits dans d'autres alcôves. De son vrai nom Nadia-Alexandra Polizu-Michsunesti, Sandi la Roumaine fut toute sa courte vie subjuguée par son Jef et accepta les sacrifices qu'exigeait l'amour pour un homme qui s'était juré de ne jamais rien se refuser.
Kessel aima passionnément sa «Sandinette» jusqu'à embrasser chaque soir un petit portrait d'elle soigneusement glissé dans ses bagages aux heures du départ. Mais au cours des longs mois où Sandi s'éteindra lentement au sanatorium de Davos, son héros préférera souvent aux visites à la malade les nuits tsiganes du Caveau caucasien ou l'oubli de soi dans une guerre lointaine. Les regrets seront terribles. Trente ans plus tard, il verra dans la déchéance alcoolisée de son autre amour, sa femme, la tumultueuse Michèle, la punition de tous ces manquements. Et nul ne sait s'il fit le lien entre le désespoir inguérissable de la belle Irlandaise et le refus de son mari de; lui donner ce qu'elle désirait de toute son âme: un enfant.
Superstitieux - pas un voyage sans prononcer le salvateur «Dobri tchass zbogom»«Que l'heure soit favorable et que Dieu nous protège.» , persuadé que tout bonheur se paie d'un chagrin et chaque rire d'une larme, il puisera dans tous ses remords d'admirables pages du «Tour du malheur», le plus tolstoïen de ses livres. Son ami Yves Courrière parlera du «vide affreux de son mie qu'il devait remplir à tout prix». Pour s'étourdir à ce point, il lui fallait bien trois patries.
Attaché à la France qui l'avait sauvé, puis à Israël qu'il fallait aider à vivre, Kessel sera ensorcelé par l'Afghanistan, découvert sur le tard. Avec une énergie intacte, à peine altérée par soixante ans de cavale et d'embardées alcoolisées, il s'enfonce jusqu'aux confins russo-afghans pour en humer les parfums, si proches de l'Oural de son enfance. C'est par l'image que cet écrivain décide de faire aimer cette terre encore inconnue. Cette fois encore, il voit grand et rêve d'un film. Il a déjà le titre: «la Passe du diable». Derrière la caméra, le jeune chef opérateur débutant s'appelle Pierre Schoendoerffer. Un jeu cruel, le bouzkachi, où les meilleurs cavaliers du pays se disputent avec sauvagerie la dépouille d'un bouc remplie d'eau et de sable, sert de prétexte à montrer du pays. A la tombée de la nuit, l'équipe de jeunes cinéastes découvre avec stupéfaction l'attaché-case usé de Kessel: un bar miniature dont l'académicien fait un usage immodéré, devant les «frères» afghans scandalisés. Car Kessel fut toute sa vie un bad boy incontrôlable, qui broyait ses verres de vodka avec les dents dans toutes les tavernes du monde comme dans les très sélectes réceptions chez Gallimard, devant la femme de Gaston tétanisée par ce Capitaine Fracasse - c'est ainsi qu'on l'appelait du côté de Montmartre - en train de croquer le cristal familial avec aplomb.
«La Passe du diable» fut occulté par la guerre d'Algérie. En revanche, «les Cavaliers» fut salué comme un chef d'oeuvre, ce qui lui vaudra lors d'un retour à Kaboul une standing ovation des moudjahidin reconnaissants. L'écrivain glissa son testament d'homme et de voyageur dans cette bible ethnologique, qui continue d'influencer les grands reporters de la presse écrite à l'heure du bouquet satellite et des tour-opérateurs. Mais cette passion afghane, qui remplirait à elle seule la vie d'un honnête homme, fut presque un détail dans l'existence de ce géant hyperactif. Il faudra d'ailleurs à son amiYves Courrière, qui fit pour Kessel ce que Kessel avait fait pour Mermoz, pas moins de mille pages intenses pour faire le tour de l'Homo kesselianus.
«Le Tour du malheur», tomes 1 et 2 Folio
«Mermoz», Folio.«Les Coeurs purs», Folio
«Nuits de prince», Folio«Le Lion», Folio
«La Passante du Sans-Souci», Folio.
«Le Petit Ane blanc», Folio
«Les Cavaliers», Folio.
«Terre d'amour et de feu», 10/18.
«Joseph Kessel ou Sur la piste du lion», par Yves Courrière, Plon.
«Kessel. Le nomade éternel», par Olivier Weber, Arthaud.
Né en 1898 à Clara, dans la pampa argentine, Joseph Kessel fut grand reporter pour "France-Soir". Il est l'auteur d'une soixantaine de romans, de nouvelles et de récits. En 1962, il est élu à l'Académie française au siège du Duc de la Force. Il meurt en juillet 1979 devant le journal télévisé, après avoir allumé sa dernière cigarette.
Anne Crignon
Le Nouvel Observateur - 2229 - 26/07/2007
Source:http://livres.nouvelobs.com/p2229/a350688.html




 Organisatrice de l'évènement : l'association Péplum, à l'origine depuis deux ans déjà, en collaboration avec le Mapa, de deux journées avec défilé romain, combats de gladiateurs et visites thématiques qui attiraient près de 6.000 visiteurs.
Organisatrice de l'évènement : l'association Péplum, à l'origine depuis deux ans déjà, en collaboration avec le Mapa, de deux journées avec défilé romain, combats de gladiateurs et visites thématiques qui attiraient près de 6.000 visiteurs.